-
Par Liviaaugustae le 25 Avril 2011 à 16:27
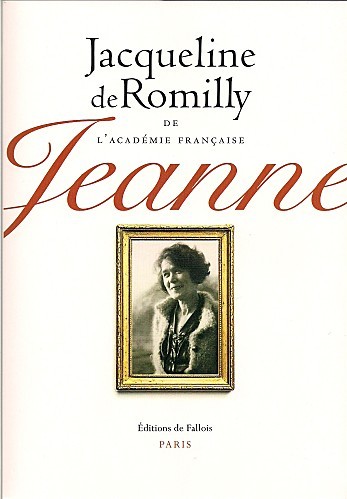
Le livre posthume de Jacqueline de Romilly, est une symphonie d’Amour, d’Amitié et d’Admiration envers Jeanne, sa mère qui l’a élevée seule, son père étant décédé en 14/18, alors qu’elle n’était qu’une toute petite fille.
[…] Je la revois quand elle sortait le soir et qu’elle venait me dire bonsoir : l’émerveillement de Proust en pareille circonstance n’était rien à côté du mien. Je ma rappelle les robes d’alors, mi-longues, les longs décolletés souples, vagues, les grands colliers… Ou peut-être n’ai-je à moi, vraiment, qu’un souvenir de parfum, de tendresse et de poudre de riz, avec le contact des mains fraîches aux jolies bagues sans valeur… Mais c’est qu’elle voulait être élégante, séduisante, charmante, tout en restant transparente et rieuse comme une jeune fille. […]
[…] J’ai déjà comparé sa vaillance à une flamme. La comparaison me revient à chaque instant ; et elle peut paraître bizarre. Car l’idée de quelque chose de droit, que rien ne peut courber, s’accorde mal avec la flamme : une flamme se courbe sans cesse, se retourne toute en souplesse. Alors pourquoi ? Pourquoi, sinon parce que la flamme suggère la parfaite pureté, l’absence de lourdeur, de scories, de malpropretés. Jeanne avait la souplesse rieuse de la flamme, mais elle en avait aussi l’éclat et l’absolue pureté ; […]
[…] Elle avait des bijoux fantaisie, mais j’eu un collier d’or, que je porte encore aujourd’hui, que je n’ai jamais quitté.
La façon dont je l’eu illustre à merveille ce que Jeanne attendait de l’argent. L’épisode prit place quelques années plus tard : je devais avoir quatorze ou quinze ans. Mais il aurait pu prendre place n’importe quand, une fois Jeanne riche… J’étais allé passer la fin de l’après-midi chez ma petite amie Antoinette… Elle avait un petit collier de perles d’or, qu’elle me fit essayer ; elle trouva qu’il m’allait si bien qu’elle voulut me le faire emporter au cou, pour que Jeanne pût l’admirer. Je devais être étonnamment fière, et cette fierté émut Jeanne. Le lendemain soir, elle avait fait les grands bijoutiers de Paris et une boîte m’attendait : un collier d’or, pareil à celui d’Antoinette, à cela que les près que les perles étaient d’or plein et de taille inégale, comme un collier de perles – à cela près, donc, qu’il était encore plus beau ! J’écris cette histoire un demi- siècle plus tard ; mais ce collier n’a jamais quitté mon cou depuis lors […]
Extraits de : JEANNE.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Liviaaugustae le 11 Avril 2011 à 15:42

En rose et bleu splendeur du crépuscule…
CREPUSCULE.
Elle est belle encore, et désirable, mais c’est un chant du cygne au crépuscule, elle jette ses derniers feux et ne l’ignore pas. D’où cette douceur empreinte de résignation, qu’elle n’avait pas avant. Elle lutte encore, courageusement, pathétiquement, telle la petite chèvre de Monsieur Seguin. Elle fait de l’aquagym, du yoga ou du vélo d’appartement. Elle mange bio en évitant les graisses, le sucre et l’alcool.
Eventuellement, si elle «en a les moyens, elle va chez ce carrossier qu’on appelle « chirurgien esthétique » pour un rafistolage ici ou là. Mais son garagiste, autrement dit son médecin, ne la berce pas d’illusions : le moteur tourne bien. Mais au ralenti, et sous réserve de changer certaines pièces. Elle s’y résoudra. Elle use d’onguents pour cacher tant soi peu les rides autour du cou et les poches sous les yeux ; et voit dans son cabinet de toilette une batterie de crèmes amincissantes aux fins aléatoires d’effacer « la culotte de cheval ».
Elle a soixante ans, un peu plus, un peu moins. Ses enfants sont casés, sauf le dernier qui glande de stages non rémunérés en petits jobs payés au SMIC. Les aînés sont mariés, ils ont des enfants, elle est donc grand-mère et ce rôle lui convient : garder le bébé de sa fille lui rappelle l’époque où elle pouponnait. Du reste, sa fille lui ressemble – en plus jeune- elle en conçoit un mixte de fierté et de jalousie. En ce temps-là les hommes lui faisaient la cour, souvent. Ca arrive encore. Moins souvent, et son mari qui était alors jaloux comme un tigre s’en fout éperdument. Si tant est qu’elle ait gardé son mari ; ils ont tendance à se faire la malle avec des jeunettes. L’inverse est plus rare. Ce mari qui l’a longtemps exaspéré et qu’elle trouvait peu romantique, voilà qu’il l’attendrit. Lui aussi a peur de vieillir. Elle sourit avec un rien de mélancolie en le voyant pointer sa brioche en tenue de jogging ou revenir de chez le coiffeur avec un zeste de rose sur le cheveu. Elle sourit même quand il drague ses copines du club de peinture ou de chorale. Sourire jaune sur les bords, mieux vaut se méfier. Au fond, elle l’a toujours aimé, ils vont finir leurs jours ensemble, il y aura d’autres petits-enfants. « Tout fini bien puisque tout finit », écrivait Chardonne. Tout finirait bien si ses parents allaient moins mal. Ils sont âgés et sa mère, hélas, vient de se fracturer le col du fémur. Visites obligées à l’hôpital. Quant à son père, le début d’Alzheimer ne présage rien de bon. C’est la vie. Elle tâche de la prendre à la bonne et, dans ses moments d’euphorie, il lui semble qu’elle goûte plus intensément un lever de soleil sur la colline, le chant d’un merle, un sourire, une sonate, un geste affectueux de son fils ou de son mari. Elle se sent précaire et fragile, ça l’attendrit, ça la rend philosophe, elle se dit qu’il faut glaner autant de bonheur que possible. Des petits bonheurs au pluriel et sans majuscule : l’âge des vastes chimères est révolu, elle hausse les épaules en écoutant ses palabrer sur la nécessité de bâtir un monde meilleur. Comme si le monde pouvait changer ! […]
Bref, nonobstant des menus soucis de santé, la femme de soixante ans peut voir la vie en rose. Un certain rose, celui des ciels d’automne. Par pudeur ou coquetterie, elle se proclame « vieille ». Elle le sera un jour, elle ne l’est pas encore et elle a très envie qu’on la rassure. Le meilleur moyen est de la courtiser, et s’il s’ensuit un flirt, ou d’avantage, le séducteur s’apercevra que le goût de ses lèvres est aussi printanier que celui d’une minette.
DENIS TILLINAC extraits de : Ce qui reste des jours (La Montagne, 24 juin 2007)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Liviaaugustae le 31 Mars 2011 à 11:14
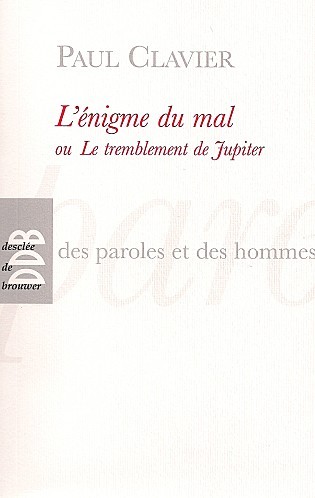
Paul CLAVIER, agrégé et docteur en philosophie, enseigne à l’Ecole normale supérieure, rue d’Ulm, à Paris.
PROLOGUE.
(extraits)
Autrefois, les grandes catastrophes étaient attribuées à la colère des dieux. Neptune ébranlait la terre. Mars déchainait la guerre. Jupiter tonnant lançait la foudre. L’Eternel en colère provoquait le Déluge, envoyait des nuées de sauterelles, faisait pleuvoir du sang, frappait les nouveau-nés… Avec le temps Dieu semble avoir renoncé à ces traitements cruels : il est devenu le « bon Dieu ». Du coup, on ne sait plus comment interpréter ces drames. Séismes, inondations, massacres, génocides : d’où viennent ces fléaux, et pourquoi ce Dieu bon n’intervient-il pas ? Le déchaînement du mal avait une explication, il devient une énigme. Comment la résoudre ? Le Dieu jaloux était tout-puissant. En devenant bon, n’aurait-il pas renoncé à sa toute-puissance ? Jupiter ne fait plus trembler l’univers. C’est lui qui tremble devant le mal. Telle est la conclusion désormais classique, quasiment obligatoire, de toute méditation sur les malheurs de tous les temps. Là-dessus, croyants et non-croyants tombent d’accord : ou bien le bon Dieu n’existe pas, ou bien il n’est pas tout-puissant. Voilà comment on a cru lever un coin de voile de l’énigme du mal. […]
Du mal on ne peut rien conclure. Et surtout pas qu’il ruine forcément la toute-puissance de Dieu. Tout ce qu’on peut dire, c’est que Dieu n’exerce pas sa toute-puissance comme nous le ferions. […]
Décréter l’impuissance de Dieu est toujours bien vu. Le décrire vacillant, gâteux, tremblotant nous rassure. Pourtant, c’est un piètre lot de consolation. Et si ce prétendu remède se révélait… pire que le mal ?
- F.C. - Vous nous conviez à une expérience originale sur la toute-puissance. Pouvez-vous la résumer ?
P.C. - Afin de rendre la méditation sur cette douloureuse question un peu plus joviale, je propose une divertissante expérience de pensée, inspirée du film de Thom Shadyac « Bruce tout-puissant ». Si nous avions les pleins pouvoirs, comment les exercerions-nous ? Quelles maladies éradiquerions-nous ? Quels crimes stopperions-nous ? A partir de combien de victimes devrions-nous intervenir ? Où serait notre « seuil de tolérance » ? Pourquoi pas plus tôt ? Pourquoi telle maladie, et pas telles autres ? Pourquoi telles victimes de telles guerres et pas telles autres ? Et surtout, pourrions-nous le faire sans détruire du même coup la liberté et la responsabilité humaines ?
J’invite mon lecteur à se poser loyalement ces questions. Elles m’ont dissuadé de faire la leçon à Dieu ou de conclure que puisqu’il n’intervient pas comme je serai tenté de le faire, c’est qu’il est impuissant. Il faut plutôt comprendre que Dieu n’exerce pas la toute-puissance comme nous serions tentés de le faire. C’est-à-dire, soyons francs… en cassant la gueule à tous nos ennemis.
- F.C. - La théologienne France Quéré disait : « Dieu est innocent de la toute-puissance dont certains veulent l’accabler ». Qu’en pensez-vous ?
P.C. – Je pense que, pour nous sauver de la mort et du péché, Dieu a vraiment intérêt à être tout-puissant, sinon sa publicité sera mensongère. Le « Dieu faible » est un joli paradoxe pour théologiens, mais si vraiment Dieu avait renoncé à sa toute-puissance, nous serions mal barrés. Il faudrait remplacer « Mais délivre-nous du mal » par « Fais ce que tu peux, c’est-à-dire pas grand-chose ».
S’il y a une faiblesse de Dieu, elle est volontaire. Jésus, librement, ne retient pas le rang qui l’égale à Dieu, nous dit Saint Paul. Donc je pense plutôt que Dieu est innocent de l’impuissance dont on veut L’accabler. C’est plutôt nous qui serions coupables de plaquer Dieu sur nos réactions psychologiques, au demeurant saines, de douleur et de respect. […]
De même, vous n’allez pas dire à un ami : « les médecins auraient pu sauver ta femme et stopper son hémorragie, mais ils ont préféré économiser des compresses ». La seule réponse humaine, c’est : « les médecins n’ont rien pu faire ». Mais justement, c’est une réponse humaine, trop humaine. Dieu n’est pas un service d’urgence débordé par les évènements ou confronté à des suppressions d’effectifs.
- F.C. Dans le fond, quelle est votre conclusion ? Avez-vous résolu l’énigme du mal ?
-P.C. – Je n’en ai pas la prétention. J’ai seulement voulu écarter une fausse piste. Je n’ignore pas que, derrière l’énigme, il y a, plus profondément, le mystère d’une désobéissance, d’une révolte originelle dans la Création. Que gagne-t-on à faire de Dieu un vieillard qui assiste impotent, à la destruction de son œuvre ? On ne console personne. Pire, on dénonce toute espérance. Car ne l’oublions pas : ce qui est en jeu, c’est l’espérance de la libération de la mort et du péché.
Je suis frappé de voir au contraire que les martyrs d’Israël ont toujours puisé l’espérance dans la confession de la toute-puissance de Dieu (2M7, 22). Seul Celui qui nous a faits de rien et qui tient en sa puissance l’existence de toute chose, peut nous sauver. Toute autre promesse de salut relève de l »imagination.
Je pense aussi à Thomas More : « Rien ne peut arriver que Dieu ne l’ait voulu ? Or tout ce qu’il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu’il y a de meilleur pour nous » (Catéchisme 313). C’est sans doute dur à avaler, mais toutes nos épreuves ne le sont-elles pas ? Alors, autant les vivre avec de bonnes raisons d’espérer.
Extrait des propos recueillis par Luc Adrian pour Famille Chrétienne du 05 mars N° 1729.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Liviaaugustae le 29 Mars 2011 à 17:41

La Mondialisation…
Un tout petit Village.
La planète est devenue un tout petit village. Notre nourriture, nos vêtements, nos équipements, la musique que nous écoutons, les images que nous visionnons viennent des cinq continents et quand le Sénégalais Diouf réussit un dribble à Séoul, on l’admire à Toronto où un Pape polonais qui réside à Rome vient de délivrer en latin un message aussi universel que le dernier livre du Péruvien Vargas Llosa. Ce roman inspire, aux mots près, les mêmes réflexions aux intellos de New-York et à ceux du Quartier Latin. Harry Potter a autant de fans à Riga qu’à Buenaventura. Les accoutrements estivaux de la jeunesse sont identiques sur les plages d’Acapulco et d’Argelès-sur-Mer et le vingt-cinquième anniversaire de la mort d’Elvis Presley va réveiller autant de nostalgies en Ossétie qu’en Australie. Nos cœurs battent de plus en plus souvent au même rythme et nous ramons tous sur la même galère ; cette évidence pénètre les esprits les plus obtus, tant mieux ; la conscience de l’unité du destin de l’homme sonne à terme le glas des tyrans, parce que désormais tout se sait, partout, en temps réel.
Ne versons pas pour autant dans un optimisme béat. Il y a lieu de redouter les effets de la globalisation, quand un Messier ou un Ben Laden projettent leurs fantasmes, prométhéens ou nihilistes : ce village désormais planétaire, il va falloir apprendre à le gérer ensemble au lieu d’en confier le destin aux multinationales du fric ou du terrorisme. Il va falloir apprendre aussi à en devenir citoyens sans perdre nos ancrages. Le métissage des êtres et des idées nous enrichit tous ; le cosmopolitisme n’est qu’une caricature de l’universalisme, il décervelle sous couvert d’additionner. Plus une maison est solide, moins on risque son éboulement en ouvrant les portes et les fenêtres. Je me sens foncièrement catholique (l’âme), profondément français (la mémoire collective), farouchement corrézien (la poésie privée), résolument européen (la nécessité), largement occidental (la culture). Fort de cet héritage, aucune pulsion raciste ou xénophobe ne peut me tarauder, je ne suis pas tenté par le replie sur une base ethnique, géographique ou mythologique.
On est chez soi partout quand on possède son royaume intime. On peut nomadiser n’importe où quand on ne perd pas de vue ses phares dans la nuit des pires solitudes. On est porté à la tolérance quand on recèle en son for les valeurs qui la fondent. Certains intellectuels dénoncent l’attachement aux racines, en quoi ils voient le risque d’une dérive identitaire. Ce mot – identité - leur fait peur, ils le diabolisent, ils veulent y voir un symptôme de pétainisme et même de fascisme. C’est idiot : le péril, dans un monde où les connections deviennent inextricables, ne viendra pas des patriotes mais des paumés en mal d’identité. Ou qui échoueront à assumer des identités trop floues pour ne pas être contradictoires.
DENNIS TILLINAC : Ce qui reste des jours (La Dépêche 18 janvier 2004)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Liviaaugustae le 23 Mars 2011 à 17:39
CHAMPAGNE !

Ses yeux s’embuent, ses joues rosissent, ses lèvres passent aux aveux : enfin elle succombe à mes assauts.
Champagne ! Zidane à driblé le dernier défenseur, ajusté son tir […]
Champagne ! Par miracle ma fille a filouté son Deug, son frère est décrété bachelier.
Champagne avec mes copains de régiment, ou de fac, ou de club, on a prémédité un dégagement dans une gargote à l’ancienne.
Champagne pour arroser la nostalgie de nos tendres années !
Champagne de rigueur pour les cérémonies de famille, champagne buissonnier pour les joies octroyées par les caprices du hasard. Les vins ont leurs vertus, les apéritifs leurs raisons d’être, et les diners virils exigent un alcool en guise d’épilogue.
Mais le champagne, c’est la vie à la hausse, à la diable, à la roulette russe. Quand le bouchon saute, les cœurs battent la chamade.
Quand les bulles s’avisent de pétiller dans la coupe ou la flûte de cristal, l’esprit des lieux revêt ses habits de lumière, on s’évade des réalités. La souillon se métamorphose en duchesse, le bureaucrate en James Dean, le technocrate en d’Artagnan, le gazetier de sous-préfecture en un mixte de Fitzgerald, d’Hemingway et de Kessel ; et l’obscur conseiller général se voit à l’Elysée… Toute métamorphose est plausible avec la magie du champagne. Elle hisse les songes au-dessus de leur étiage, elle instaure dans l’âme une sorte de faste luxueux, soyeux, capiteux, faramineux. Certes, la mythologie qui enlumine ce vin le prédispose à incarner les fêtes galantes dans des décors ébauchés par un Proust, un Radiguet ou un Cocteau. Mais sa texture, sa façon à la fois audacieuse et subtile de titiller la langue, ses arômes de pomme et pain grillé suffiraient à nous enrôler dans un univers où l’élégance va de soi. C’est pourquoi il faut le lamper comme un élixir d’alchimiste, pas le picoler. N’importe où, mais pas n’importe quand : il convient que les circonstances s’y prêtent, quitte à manier le paradoxe. […]
Il y a des fraternités d’armes qui s’entretiennent à la bière, des exaltations dont le rouge force la note. Le champagne, c’est pour les affinités électives, les soupers d’amoureux, les commémorations intimes. Il parachève un banquet, par devoir d’Etat, et s’impose dans tout cocktail de bon aloi. Cependant sa vocation foncière n’est pas d’ajouter une ivresse à une autre, ni même d’inaugurer une fiesta ; elle consiste plutôt à inoculer, au plus secret des neurones, une sorte d’ivresse de la sensibilité qui rapproche tout un chacun de ce qu’il aurait voulu, de ce qu’il aurait pu, de ce qu’il aurait dû. Et toujours en le tirant par le haut. Un culte ordinaire m’inspire des fantasmes de soudard ; un abus de champagne me prête une âme d’élite. […]
On reste toujours tributaire de nos chimères juvéniles. L’étudiant désargenté que je fus voulait devenir écrivain. Cet état mirifique était associé, entre autres images, à celle-ci : moi juché sur un tabouret au bar du Ritz, une coupe de champagne à la main. Une pour commencer en solitaire, les suivantes me consentiraient un sillage d’esprits déliés et de minettes à l’unisson. Du temps a passé, ma jeunesse s’est évaporée, j’ai gâché de l’encre et bu du champagne en surabondance, au Ritz et ailleurs, du blanc et du rosé. En se trempant dans ce breuvage, ma plume a-t-elle gagné en fluidité ? Je ne sais. Reste en mon for la conviction qu’il a partie liée avec une forme d’ennoblissement. A cet égard, il conforte légitimement notre patriotisme : le champagne, c’est la France.
On repère facilement son terroir sur les cartes de l’Hexagone, non loin de Reims où débuta en quelque sorte l’histoire de notre vieux pays. Chaque fois qu’au large d’Epernay, j’aperçois ses vignes, une fierté cocardière me surprend. Partout dans le monde, à l’instant où les bulles se mettent à pétiller, le génie français s’insinue dans le cerveau, et le butor le plus calamiteux devient peu ou prou un « French Lover » irrésistible. Il lui suffit d’énoncer dans sa langue la devise de Blondin : « remettez-nous ça ! » et le voilà habité par les mânes d’Athos.
DENIS TILLINAC extrait de : Ce qui reste des jours. (Le figaro magasine, 26 novembre 2005)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique




