-
LES ROIS.Coutume.Lors des Saturnales (fêtes romaines sur la fin du mois de décembre et au commencement de janvier), les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un jour ». Les Saturnales étaient en effet une fête d’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne, divinité chtonienne. Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique) au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme « bulletin de vote » pour élire le « Saturnalicius princeps » (Maître des Saturnales ou Roi du désordre). Cela permettait de resserrer les affections domestiques et donnait au « roi d’un jour » le pouvoir d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant d’être mis à mort, ou plus probablement de retourner à sa vie servile à l’issue de celle-ci. Pour assurer une distribution aléatoire des parts de galette, il était de coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la personne chargée du service (d’où l’usage toujours vivant de « tirer les rois »). Tacite écrit que, dans les fêtes consacrées à Saturne, il était d’usage de tirer au sort la royauté3.Étienne Pasquier a décrit dans ses Recherches de la France4 les cérémonies qui s’observaient en cette occasion : « Le gâteau, coupé en autant de parts qu’il y a de conviés, on met un petit enfant sous la table, lequel le maitre interroge sous le nom de Phébé (Phœbus ou Apollon), comme si ce fût un qui, en l’innocence de son âge, représentât un oracle d’Apollon. À cet interrogatoire, l’enfant répond d’un mot latin domine (seigneur, maître). Sur cela, le maître l’adjure de dire à qui il distribuera la portion du gâteau qu’il tient en sa main, l’enfant le nomme ainsi qu’il lui tombe en la pensée, sans acception de la dignité des personnes, jusqu’à ce que la part soit donnée où est la fève ; celui qui l’a est réputé roi de la compagnie encore qu’il soit moindre en autorité. Et, ce fait, chacun se déborde à boire, manger et danser. »C’est cet usage qui est passé jusqu’à nous. On en retrouve la trace non seulement dans le rituel de la galette des Rois, mais aussi dans la fête des Fous médiévale et des « rois et reines » des carnavals actuels.Fèves.À la fin du XVIIIe siècle, des fèves en porcelaine apparurent, représentant l’enfant Jésus en porcelaine. Sous la Révolution, on remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. Les graines de fève furent systématiquement remplacées en 1870 par des figurines en porcelaine ou – plus récemment – en plastique. De nos jours, si on trouve toujours de vraies fèves, il existe une multitude de fèves fantaisie qui font le bonheur de collectionneurs : la collection de ces petits objets se nomme la favophilie.HistoireJadis, l’usage voulait que l’on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière, appelée « part du Bon Dieu », « part de la Vierge » ou « part du pauvre » était destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis. Au Moyen Âge, les grands nommaient quelquefois le roi du festin, dont on s’amusait pendant le repas. L’auteur de la vie du duc Louis II de Bourbon, voulant montrer quelle était la piété de ce prince, remarque que, le jour des Rois, il faisait roi un enfant de huit ans, le plus pauvre que l’on trouvât en toute la ville. Il le revêtait d’habits royaux, et lui donnait ses propres officiers pour le servir. Le lendemain, l’enfant mangeait encore à la table du duc, puis venait son maitre d’hôtel qui faisait la quête pour le pauvre roi. Le duc de Bourbon lui donnait communément quarante livres et tous les chevaliers de la cour chacun un franc, et les écuyers chacun un demi-franc. La somme montait à près de cent francs que l’on donnait au père et à la mère pour que leur enfant fût élevé à l’école. Le royaume de France se partageait alors en langue d'oc où l’on fabriquait toujours un gâteau des rois (la recette de la pâte variant suivant les régions : flamusse de Bresse, patissous du Périgord, coque des rois ariégeoise, Royaume des cévennes, garfou du Béarn, goumeau de Franche Comté, etc.) et langue d'oïl où l’on préparait dès le XVe siècle un dessert de pâte sablée fourré de crème d’amandes qui devient plus tard une pâte levée à la levure de bière nommée gorenflot.On tirait le gâteau des Rois même à la table de Louis XIV. Dans ses Mémoires, Françoise de Motteville écrit, à l’année 1648, que : « Ce soir, la reine nous fit l’honneur de nous faire apporter un gâteau à Mme de Brégy, à ma sœur et à moi ; nous le séparâmes avec elle. Nous bûmes à sa santé avec de l’hippocras qu’elle nous fit apporter. » Un autre passage des mêmes Mémoires atteste que, suivant un usage qui s’observe encore dans quelques provinces, on réservait pour la Vierge une part qu’on distribuait ensuite aux pauvres. « Pour divertir le roi, écrit Françoise de Motteville à l’année 1649, la reine voulut séparer un gâteau et nous fit l’honneur de nous y faire prendre part avec le roi et elle. Nous la fîmes la reine de la fève, parce que la fève s’était trouvée dans la part de la Vierge. Elle commanda qu’on nous apportât une bouteille d’hippocras, dont nous bûmes devant elle, et nous la forçâmes d’en boire un peu. Nous voulûmes satisfaire aux extravagantes folies de ce jour, et nous criâmes : La reine boit ! » Avant Louis XIV, les grandes dames qui tiraient la fève devenaient reines de France d’un jour et pouvaient demander au roi un vœu dit « grâces et gentillesses » mais « le Roi Soleil » abolit cette coutume.Louis XIV conserva toujours l’usage du gâteau des Rois, même à une époque où sa cour était soumise à une rigoureuse étiquette. Le Mercure galant de janvier 1684 décrit la salle comme ayant cinq tables : une pour les princes et seigneurs, et quatre pour les dames. La première table était tenue par le roi, la seconde par le dauphin. On tira la fève à toutes les cinq. Le grand écuyer fut roi à la table des hommes; aux quatre tables des femmes, la reine fut une femme. Alors le roi et la reine se choisirent des ministres, chacun dans leur petit royaume, et nommèrent des ambassadrices ou ambassadeurs pour aller féliciter les puissances voisines et leur proposer des alliances et des traités. Louis XIV accompagna l’ambassadrice députée par la reine. Il porta la parole pour elle, et, après un compliment gracieux au grand écuyer, il lui demanda sa protection que celui-ci lui promit, en ajoutant que, s’il n’avait point une fortune faite, il méritait qu’on la lui fit. La députation se rendit ensuite aux autres tables, et successivement les députés de celles-ci vinrent de même à celle de Sa Majesté. Quelques-uns même d’entre eux, hommes et femmes, mirent dans leurs discours et dans leurs propositions d’alliance tant de finesse et d’esprit, des allusions si heureuses, des plaisanteries si adroites, que ce fut pour l’assemblée un véritable divertissement. En un mot, le roi s’en amusa tellement, qu’il voulut le recommencer encore la semaine suivante. Cette fois-ci, ce fut à lui qu’échut la fève du gâteau de sa table, et par lui en conséquence que commencèrent les compliments de félicitation. Une princesse, une de ses filles naturelles, connue dans l’histoire de ce temps-là par quelques étourderies, ayant envoyé lui demander sa protection pour tous les évènements fâcheux qui pourraient lui arriver pendant sa vie. « Je la lui promets, répondit-il, pourvu qu’elle ne se les attire pas. » Cette réponse fit dire à un courtisan que ce roi-là ne parlait pas en roi de la fève. À la table des hommes, on fit un personnage de carnaval qu’on promena par la salle en chantant une chanson burlesque. La galette proprement dite (pâte feuilletée plus crème frangipane) apparut au XVIIe siècle, Anne d’Autriche et son jeune fils Louis XIV en partagèrent une la veille de l’épiphanie de 1650.En 1711, le Parlement délibéra, à cause de la famine, de le proscrire afin que la farine, trop rare, soit uniquement employée à faire du pain. Au commencement du XVIIIe siècle, les boulangers envoyaient ordinairement un gâteau des Rois à leurs pratiques. Les pâtissiers réclamèrent contre cet usage et intentèrent même un procès aux boulangers comme usurpant leurs droits. Sur leur requête, le parlement rendit, en 1713 et 1717, des arrêts qui interdisaient aux boulangers de faire et de donner, à l’avenir, aucune espèce de pâtisserie, d’employer du beurre et des œufs dans leur pâte, et même de dorer leur pain avec des œufs. La défense n’eut d’effet que pour Paris et l’usage prohibé continua d’exister dans la plupart des provinces. Quand vint la Révolution, le nom même de « gâteau des Rois » fut un danger et Manuel, du haut de la tribune de la Convention, tenta sans succès d’obtenir l’interdiction du gâteau des Rois (son nom fut même un temps remplacé par la galette de l’égalité), mais la galette triompha du tribun. Peu après, un arrêté de la Commune ayant changé le jour des Rois en « jour des sans-culottes », le gâteau n’eut plus sa raison d’être, mais cette disparition ne fut que momentanée car il reparut bientôt sur toutes les tables familiales dès que la conjoncture le permitTexte copié sur Wikipédia.Ma galette des Rois…Et dans leurs trésors ayant pris,Ils offrirent à Jésus-ChristLes trois présents qui sont prescritsPlus un qui ne fut pas écrit :La galette dorée au laitOù leurs Reines dans leur palaisOnt mêlé beurre, œufs et sel etLa fève sans dire où elle est…Extrait de : Almanach pour une jeune fille triste de Marie NOËL.
 votre commentaire
votre commentaire
-

PETIT POEME…
L’Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière,
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier
Avec ses petits sapins en bois d’Allemagne couverts de givre peint,
Et avec son bœuf et son âne en bois d’Allemagne. Peints.
Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas
Puisqu’elles sont en bois.
C’est une petite fille pourtant qui traversera les mondes.
Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus.
Charles Péguy
Extrait de : Almanach pour une jeune fille triste de Marie NOËL
 votre commentaire
votre commentaire
-
L’EPIPHANIE DE LUINI.
 L’Adoration des Mages est une fresque
peinte entre 1520 et 1525 par le Lombardo Bernardino Luini (1485-1532)
(Musée du Louvre)Sur le seuil d’une modeste demeure en bois et torchis, la Sainte Famille accueille ses visiteurs : Balthazar, Gaspard et Melchior.Le roi le plus âgé, à la longue barbe d’un blanc immaculé, est vêtu comme un doge de Venise mais avec un camail royal en fourrure d’hermine. Par respect, il est tête nue. Jésus le bénit. Le roi d’âge moyen est en train d’ôter son turban et sa couronne, sans quitter l’Enfant des yeux. Ces deux rois fixent sur lui un regard plein de foi et d’amour.Le plus jeune est un noir, ce qui est une nouveauté initiée par les peintres flamands de la fin du XVe siècle.Il rayonne d’une joie enfantine et montre Jésus au spectateur.Joseph, au beau profil grec, modestement en retrait, regarde par la fenêtre l’arrivée de la suite considérable des rois mages : chevaux, mulets et chameaux chargés de paquets. Un écuyer tire un tatou en laisse. Ils chevauchent et cheminent dans un paysage de rochers vaporeux à la façon de Léonard de Vinci.Luini aime, dans ses compositions, combiner la rigueur géométrique du cadre architectural « un agencement de rectangles stricts » et la douceur tout en courbes des personnages.UN PEINTRE A REDECOUVRIR :Les couleurs sont à la fois intenses et nuancées, délicates et très originales : pourpre grenat, vert émeraude un peu turquoise, bleu ciel, jaune d’or. Les rehauts d’or, fins et sans aplats, sur les auréoles, les liserés des drapés, les couronnes et les présents des mages, donnent un raffinement incomparable à cette œuvre.Né sur le lac Majeur, Luini a travaillé pour les églises de Milan. Son style mystérieux fait un peu penser à Léonard de Vinci, mais encore plus à Andrea Solario, un peintre de la même époque. Mais il n’a aucunement le cynisme septique de Léonard ; son œuvre est très spirituelle et recueillie.
L’Adoration des Mages est une fresque
peinte entre 1520 et 1525 par le Lombardo Bernardino Luini (1485-1532)
(Musée du Louvre)Sur le seuil d’une modeste demeure en bois et torchis, la Sainte Famille accueille ses visiteurs : Balthazar, Gaspard et Melchior.Le roi le plus âgé, à la longue barbe d’un blanc immaculé, est vêtu comme un doge de Venise mais avec un camail royal en fourrure d’hermine. Par respect, il est tête nue. Jésus le bénit. Le roi d’âge moyen est en train d’ôter son turban et sa couronne, sans quitter l’Enfant des yeux. Ces deux rois fixent sur lui un regard plein de foi et d’amour.Le plus jeune est un noir, ce qui est une nouveauté initiée par les peintres flamands de la fin du XVe siècle.Il rayonne d’une joie enfantine et montre Jésus au spectateur.Joseph, au beau profil grec, modestement en retrait, regarde par la fenêtre l’arrivée de la suite considérable des rois mages : chevaux, mulets et chameaux chargés de paquets. Un écuyer tire un tatou en laisse. Ils chevauchent et cheminent dans un paysage de rochers vaporeux à la façon de Léonard de Vinci.Luini aime, dans ses compositions, combiner la rigueur géométrique du cadre architectural « un agencement de rectangles stricts » et la douceur tout en courbes des personnages.UN PEINTRE A REDECOUVRIR :Les couleurs sont à la fois intenses et nuancées, délicates et très originales : pourpre grenat, vert émeraude un peu turquoise, bleu ciel, jaune d’or. Les rehauts d’or, fins et sans aplats, sur les auréoles, les liserés des drapés, les couronnes et les présents des mages, donnent un raffinement incomparable à cette œuvre.Né sur le lac Majeur, Luini a travaillé pour les églises de Milan. Son style mystérieux fait un peu penser à Léonard de Vinci, mais encore plus à Andrea Solario, un peintre de la même époque. Mais il n’a aucunement le cynisme septique de Léonard ; son œuvre est très spirituelle et recueillie. Le vase en or, au premier plan posé par
terre par le premier mage, contraste avec la pauvreté du seuil de la maison.
Le vase en or, au premier plan posé par
terre par le premier mage, contraste avec la pauvreté du seuil de la maison.
Marie-Gabrielle LEBLANC
Extrait de : Famille Chrétienne
 votre commentaire
votre commentaire
-
UN PATRIMOINE QUI NOUS VIENT DE LA NUIT DES TEMPS…LE PAIN !
 « Comme je mordais dans mon pain,Un bouvreuil s’est mis à chanter,A chanter par-dessus mon pain.Un enfant souriait dans l’ombre.Je mangeais du pain de bouvreuilSous un sapin de l’autre monde.Mon Dieu ! Comme il faut peu de chosePour qu’un pain devienne clarté !Il suffit parfois d’une rosePour respirer tout son passé.MAURICE CAREME.Extrait de : La terre, le feu, le Pain de Christine Guénanten.
« Comme je mordais dans mon pain,Un bouvreuil s’est mis à chanter,A chanter par-dessus mon pain.Un enfant souriait dans l’ombre.Je mangeais du pain de bouvreuilSous un sapin de l’autre monde.Mon Dieu ! Comme il faut peu de chosePour qu’un pain devienne clarté !Il suffit parfois d’une rosePour respirer tout son passé.MAURICE CAREME.Extrait de : La terre, le feu, le Pain de Christine Guénanten. votre commentaire
votre commentaire
-
LA GENTILLESSE(à rebours des clichés)
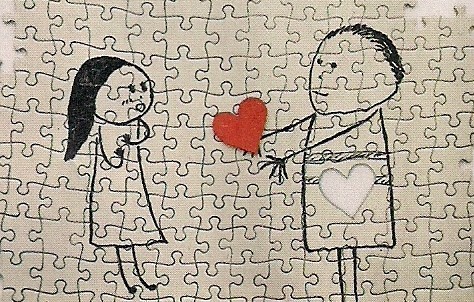 Assimilée à une forme de faiblesse, la gentillesse relève au contraire de la force d’âme.C’est ce que nous dit Emmanuel Jaffelin dans un piquant essai philosophique.La gentillesse ? Au mieux, elle est perçue comme une petite vertu un peu fade et simplette, au pire, comme une sorte de handicap qui ferait plus ou moins obstacle à la réussite.De l’enfant gentil qui donne trop facilement ses cartes de pokémon et son goûter, on dira : « il se fait avoir », « il ne sait pas se défendre »…Pourtant, c’est bien lui qui a tout compris, nous dit Emmanuel Jaffelin, auteur d’un savoureux « Petit Eloge de la gentillesse ». Agrégé de philosophie, ancien diplomate et enseignant au lycée Lakanal de Sceaux, il est parti à la recherche de ce qui pouvait constituer l’ADN de la gentillesse. « Contrairement à ce que je crois spontanément, ma force morale ne résulte pas du pouvoir que j’ai sur les autres mais de ce que je leur abandonne, écrit-il. Or la gentillesse, par le service que je rends, est don et abandon de soi. »La gentillesse serait à chercher du côté de l’intelligence du cœur et de la délicatesse morale, à la différence de la sollicitude intrusive d’une Amélie Poulain qui veut faire le bonheur des gens malgré eux, ou du simple respect qui se borne à l’obéissance aux règles de la vie en société sans vraiment inviter à s’ouvrir à l’autre.Le philosophe remonte aux origines romaines du « gentilis », désignant le noble avant d’englober les nations qui composent l’Empire, pour finalement désigner celles qui s’y opposent. Le sens de « gentil » se modifie alors pour signifier l’ »ennemi ». Les chrétiens qui cherchent un terme latin pour désigner les non-chrétiens (comme le mot goy en hébreu pour évoquer les non-juifs) vont reprendre le mot « gentil », mais sans connotation d’exclusion, car le gentil peut se convertir.C’est le monde médiéval chrétien qui redonnera à « gentil » son sens premier de « noble », en lui ajoutant sa connotation morale, liée aux valeurs chevaleresques. Jaffelin cite le bon roi Saint Louis « qui fait le bien parce qu’il est le roi, c’est-à-dire la quintessence de la noblesse ». A la Renaissance, cette morale du gentilhomme se confondra avec « celle du courtisan, qui n’accomplit rien sans arrière pensée ». A la révolution, elle sera balayée avec le reste.« La démocratie a tellement inscrit le refus de la servitude dans mes gènes que je perçois la gentillesse comme la rémanence d’un monde disparu, celui de l’Ancien Régime et de sa pratique du servage », note le philosophe.Mais face à la culture du cynisme et de la méfiance, et face au culte du « winer » qui écrase les autres pour parvenir à ses fins, il voit dans cet abandon limité, sorte d’entresol avant le sacrifice de soi, une morale du quotidien susceptible de transfigurer les relations humaines.Clotilde HAMONExtrait de : Famille Chrétienne.
Assimilée à une forme de faiblesse, la gentillesse relève au contraire de la force d’âme.C’est ce que nous dit Emmanuel Jaffelin dans un piquant essai philosophique.La gentillesse ? Au mieux, elle est perçue comme une petite vertu un peu fade et simplette, au pire, comme une sorte de handicap qui ferait plus ou moins obstacle à la réussite.De l’enfant gentil qui donne trop facilement ses cartes de pokémon et son goûter, on dira : « il se fait avoir », « il ne sait pas se défendre »…Pourtant, c’est bien lui qui a tout compris, nous dit Emmanuel Jaffelin, auteur d’un savoureux « Petit Eloge de la gentillesse ». Agrégé de philosophie, ancien diplomate et enseignant au lycée Lakanal de Sceaux, il est parti à la recherche de ce qui pouvait constituer l’ADN de la gentillesse. « Contrairement à ce que je crois spontanément, ma force morale ne résulte pas du pouvoir que j’ai sur les autres mais de ce que je leur abandonne, écrit-il. Or la gentillesse, par le service que je rends, est don et abandon de soi. »La gentillesse serait à chercher du côté de l’intelligence du cœur et de la délicatesse morale, à la différence de la sollicitude intrusive d’une Amélie Poulain qui veut faire le bonheur des gens malgré eux, ou du simple respect qui se borne à l’obéissance aux règles de la vie en société sans vraiment inviter à s’ouvrir à l’autre.Le philosophe remonte aux origines romaines du « gentilis », désignant le noble avant d’englober les nations qui composent l’Empire, pour finalement désigner celles qui s’y opposent. Le sens de « gentil » se modifie alors pour signifier l’ »ennemi ». Les chrétiens qui cherchent un terme latin pour désigner les non-chrétiens (comme le mot goy en hébreu pour évoquer les non-juifs) vont reprendre le mot « gentil », mais sans connotation d’exclusion, car le gentil peut se convertir.C’est le monde médiéval chrétien qui redonnera à « gentil » son sens premier de « noble », en lui ajoutant sa connotation morale, liée aux valeurs chevaleresques. Jaffelin cite le bon roi Saint Louis « qui fait le bien parce qu’il est le roi, c’est-à-dire la quintessence de la noblesse ». A la Renaissance, cette morale du gentilhomme se confondra avec « celle du courtisan, qui n’accomplit rien sans arrière pensée ». A la révolution, elle sera balayée avec le reste.« La démocratie a tellement inscrit le refus de la servitude dans mes gènes que je perçois la gentillesse comme la rémanence d’un monde disparu, celui de l’Ancien Régime et de sa pratique du servage », note le philosophe.Mais face à la culture du cynisme et de la méfiance, et face au culte du « winer » qui écrase les autres pour parvenir à ses fins, il voit dans cet abandon limité, sorte d’entresol avant le sacrifice de soi, une morale du quotidien susceptible de transfigurer les relations humaines.Clotilde HAMONExtrait de : Famille Chrétienne. votre commentaire
votre commentaire





